Noël Dolla est espiègle comme le sont les grands enfants. Animé d’un éternel feu intérieur, à bientôt 80 ans, l’artiste poursuit sa route, opiniâtre et ferme, contrant le vent mauvais des diktats de la bienpensance. Alerte, il perpétue l’esprit révolutionnaire du mouvement Supports/Surfaces qui l’a vu naître, investissant la scène artistique avec engagement, attentif au temps présent. Entretien avec l’un des derniers des mohicans à contre-courant.

Noël Dolla en visite au musée, admirant une œuvre de Daniel Dezeuze (*1942) en bitume de judée et scotch sur papier.
Toile rouge (1968), actuellement à l’affiche de notre musée, fait l’objet de la couverture de ce magazine. Vous souvenez-vous de l’état d’esprit dans lequel vous avez réalisé cette oeuvre, qui marque vos débuts dans l’art?
Tout a commencé avec ma confrontation avec le groupe BMPT [ndlr: le collectif formé en 1966 par les artistes Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni]. Je travaillais alors à partir de l’idée qu’une toile est simplement une bande de peinture et que cela suffisait. J’avais lu leur manifeste et je m’étais posé la question: qu’est-ce qu’il me reste à faire, à moi? Alors, j’ai réalisé une toile que j’ai peinte en partie en rouge avec une bande bleue. Je me suis mis à réduire cette bande à une ligne, et puis de la ligne, je suis passé à son origine, réduisant la ligne à un point. Ensuite, j’ai multiplié les points par trois et ça a donné toute une série de toiles que je marquais par trois points: c’était juste un marquage sans grand intérêt pour la couleur ni pour le motif. Toile rouge est un grand morceau de toile que m’a offert un ami storiste et qui se trouvait dans la réserve de son magasin. Cette oeuvre présente également des points blancs et trois points jaunes, et fait partie d’un de mes premiers triptyques.

L'imposante Toile rouge (1968) de Noël Dolla est actuellement à l’affiche de notre exposition.
Vous situez très précisément votre prise de conscience d’artiste et citez le 14 décembre 1967 comme jour inaugural de votre émergence.
En décembre 1967, je présentais chez Ben au Hall des remises en question – avec Louis Cane, Daniel Dezeuze, Patrick Saytour, Claude Viallat – un châssis de toile démonté en étendoir sur lequel j’avais accroché quelques morceaux de tissus. En passant du plan du mur à l’espace, je m’affirmais comme artiste et m’affranchissais de la peinture de chevalet.
Avec cette exposition chez Ben commence votre inclination pour le ménager, et plus particulièrement le textile de la vie ordinaire. Pour «chiffonner» les prescripteurs?
Oui, il y avait de ça… Il faut savoir que j’étais le fils aîné dans une famille très modeste qui comptait quatre garçons. Depuis l’âge de mes 13-14 ans, je faisais un peu tout à la maison. L’histoire du ménager a toujours eu une importance pour moi: le linge étendu, les serpillères, les torchons, les taies d’oreillers, les gants de toilette, les mouchoirs... Mais de manière à éviter une trop grande charge émotionnelle, j’employais toujours ces textiles à neuf, vierges de tout usage. Je n’ai jamais voulu qu’ils accroissent l’oeuvre de leur vie supplémentaire. La connotation est suffisante, la charge est déjà considérable.

L'artiste dans son atelier (c) Loupio
Il y eut pourtant une période où vous chargiez ces textiles de matières plus organiques, telle que l’urine…
Il est vrai qu’à une période donnée, j’ai eu recours à ma propre urine. Mais toujours pour rester dans l’histoire de l’art et dans l’histoire d’une pratique de la peinture. J’ai une formation technique assez importante et je me suis toujours souvenu que les hommes préhistoriques employaient du noir de charbon broyé avec de l’ocre jaune ou rouge, des terres naturelles donc qui étaient souvent mêlées à de l’urine et une graisse animale. Quand avec mon grand-père, j’ai appris à faire du faux bois et du faux marbre – c’était son métier –, je me souviens que souvent, n’ayant pas de minium de plomb, il prenait de la mine-orange qu’il mettait dans une boîte, pissait dedans et avec cette terre ainsi mélangée à de l’urine, il faisait son faux bois. Une fois le destin fait et le mélange séché, il passait une couche de vernis par-dessus à l’huile de lin. J’ai trouvé ce procédé intéressant, j’y ai recouru comme une forme de teinture et réalisé peut-être une dizaine de toiles.
Mais pour ses propriétés chimiques ou par référence à une pratique ancestrale ?
Il y avait un peu des deux. Quand je travaillais à l’urine, cela donnait des discussions interminables avec mon épouse : à force, c’était gênant car ça sentait fort dans l’atelier, qui à l’époque se trouvait dans la maison. À cette teinture artisanale, j’ajoutais un liant qui était à l’huile de lin et à l’essence de térébenthine, plus un peu de résine de ma composition qui recouvrait le tout pour le fixer définitivement. Il y avait aussi du jus d’oignon… bref, tout ça c’était du bricolage de l’époque que j’avais appris avec mon grand-père et dont je me servais pour des effets très particuliers. Autant vous dire que lorsque je suis passé de la peinture à l’huile à l’acrylique, l’odeur de tous ces produits me manquait dans l’atelier. L’acrylique, c’est âpre comme odeur, ça sent un peu le vinaigre, alors j’ajoutais quelques gouttes de térébenthine, d’huile de lin et d’essence d’aspic sur un chiffon pour embaumer l’atelier et ainsi plonger en enfance.

Croix (1976) avant son accrochage
Croix (1976), également visible dans notre accrochage, a fait l’objet d’un don au musée en 2023. Qu’en est-il de sa composition: organique ou pas ?
Le doute est permis… Cette oeuvre fait partie d’une des dernières de la série. Je m’en suis détourné après 1977 en raison de son succès – cela se vendait comme des petits pains – ou bien parce que j’en avais marre de porter ma croix tous les matins. C’est un terrain que j’ai laissé en jachère…
En 2023, vous nous apportiez dans un sac cette oeuvre pliée en quatre mais dans un ordre bien précis. Prônez-vous plutôt le rangement ou l’accrochage de l’œuvre?
Disons que lorsqu’on plie à partir de la croix, les plis se marquent sur la toile et il vaut mieux à ce moment-là la replier à chaque fois de la même manière. Quand on l’accroche au mur, normalement elle va se détendre par son propre poids, et les plis vont s’estomper suffisamment mais il restera toujours assez de marques qui sont la trace de quelque chose, avec une vie propre. Ces plis donnent à la toile une certaine ondulation qui à la lumière confère à l’oeuvre des ombres particulières. Ces plis-là sont entièrement assumés en tant que partie intégrante de l’oeuvre. Pour les tarlatanes, il y a toute une série qui s’appelle «Plis et replis». Celles qui sont enroulées, je préfère qu’on ne les froisse pas ou les plie n’importe comment. En revanche, on peut toujours, avec précaution, les repasser au fer à vapeur, avec un chiffon blanc intermédiaire. Toutes mes tarlatanes sont repassables, mais il faut faire attention aux collages.
S’agissant du service après-vente, ce n’est plus de mon ressort: je ne laisse aucune consigne directe, à moins d‘être contacté par un restaurateur pour une question spécifique.

Noël Dolla partage les coulisses de son mode opératoire à ciel ouvert dans la cour de l’atelier Friche municipale du 109, à Nice. Ici a cours un travail de teinture d’un rouleau de tarlatane dans des couleurs diluées à l’essence: une bonne raison de travailler à l’air libre. (c) Loupio
Vous-même, vous revendiquez vos origines ouvrières, mais le mouvement, bien que foncièrement gauchisant, était plutôt étranger à la réalité de cette condition sociale.
Peu de membres du groupe, à part Pincemin et moi, appartenaient à ce qu’on peut appeler le prolétariat. C’est quand même à la base un groupe d’artistes fils de bourgeois. Mais ça n’empêchait pas une conscience de classe, une volonté d’engagement très à gauche pré- et post-68. Moi, je suis un nanard communard, j’ai une bonne connaissance du marxisme: en bon anarchiste, j’ai lu Proudhon, Babeuf, Bakhtine, Louise Michel... Mais je n’ai jamais été maoïste. J’ai été membre du parti communiste pendant trois mois mais je suis parti car le secrétaire de la cellule refusait qu’on s’interroge, qu’on soulève des questions. Un imbécile!
En revanche, quand certains membres de Supports/ Surfaces ont soudain revendiqué un retour à l’usine, cela m’a mis hors de moi pour avoir trimé comme peintre en bâtiment pendant quinze ans. C’est vraiment une revendication de petit bourgeois et d’intellectuel de gauche. Cela faisait partie de nos confrontations au sein du groupe. Après, il y a l’art qui reste.
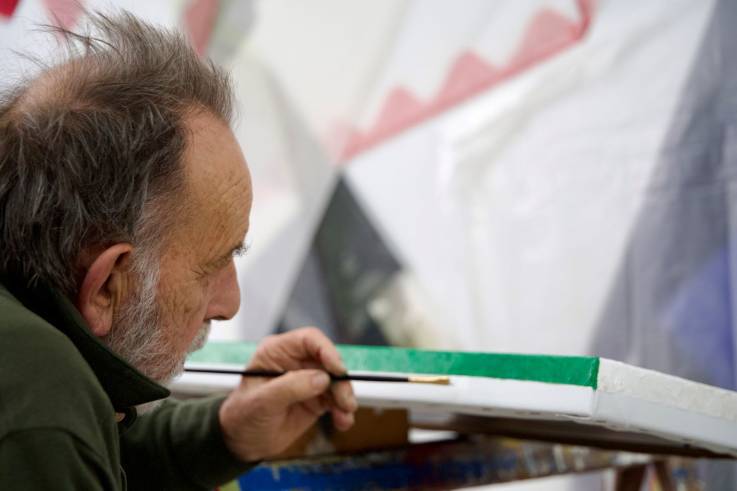
« Quand je vois aujourd’hui un retour de la peinture sur chevalet, j’y vois un crime de lèse-majesté. » (c) Loupio
Que reste-t-il de l’esprit révolutionnaire de Supports/Surfaces, qui prétendait briser les codes de la peinture?
Quand je vois aujourd’hui un retour de la peinture sur chevalet avec notamment l’actuelle exposition que le Musée d’Orsay consacre à la peinture contemporaine française, j’y vois un crime de lèse-majesté dans ce face-à-face avec le tableau: on vit une époque éminemment réactionnaire. Moi je continue à cultiver une approche dans un esprit révolutionnaire par rapport à la pratique de la peinture: je m’évertue à ne pas être un produit.
Quand je peins aujourd’hui Guerni-Gaza, dans la lignée de la série «Sniper», ou encore Sniper 14 mai 2018, ce n’est pas anodin, je sais que je vais me heurter à des confrontations. Mon art est innervé d’une conscience politique, il est engagé, c’est un manifeste contre ce qui se passe dans le monde car un artiste est là pour déplacer les croyances et les consciences. La pensée du spectateur doit pouvoir cheminer au regard de l’oeuvre. Il faut que les signes soient différents d’une oeuvre à l’autre, que la lecture soit le fruit d’un cheminement intellectuel.
Une œuvre d’art est réalisée dans le présent mais elle doit aussi s’inscrire dans le futur: l’artiste a priori est le seul à imaginer à quelle hauteur il saute! À tort ou à raison d’ailleurs. C’est une posture qu’il est difficile à faire accepter dans l’industrie culturelle. Et par les temps bien-pensants qui courent…

«La liberté de penser est capitale à mes yeux.» (c) Loupio
Qu’est-ce qui vous anime aujourd’hui dans la pratique de la peinture? Qu’est-ce qui en général vous exaspère, qu’est-ce qui vous ravit?
La liberté de penser est capitale à mes yeux: or, elle est très menacée de nos jours. On cherche à la tronçonner, à dicter ce qu’on peut dire, ne pas dire… Cela me met en colère de voir comme on nous catalogue au pied levé de ceci ou cela… Il me semble qu’on a le droit de s’interroger et de soulever des questions sur tout et tout le temps. Ce qui me ravit? Je suis encore vivant, et je me déplace encore beaucoup pour mon travail. Or n’en déplaise à certains: j’adore prendre l’avion, avoir le cul assis à 10.000 mètres d’altitude, je trouve cela formidable. Regarder la terre depuis le ciel… ça m’émerveille!
Propos recueillis par: Sonia da Silva - Photos: © loupio / Éric Chenal
Source: MuseoMag N° I - 2025
L’exposition Supports/Surfaces, à l’affiche jusqu’au 23 février 2025, a été l’occasion pour le musée de fixer en son et image quelques précieux témoignages. Outre une table ronde organisée au musée sur l’héritage de cet esprit, nous avons entrepris d’enregistrer des entretiens avec quatre témoins (dont Noël Dolla). Disponible sur notre médiathèque YouTube.

